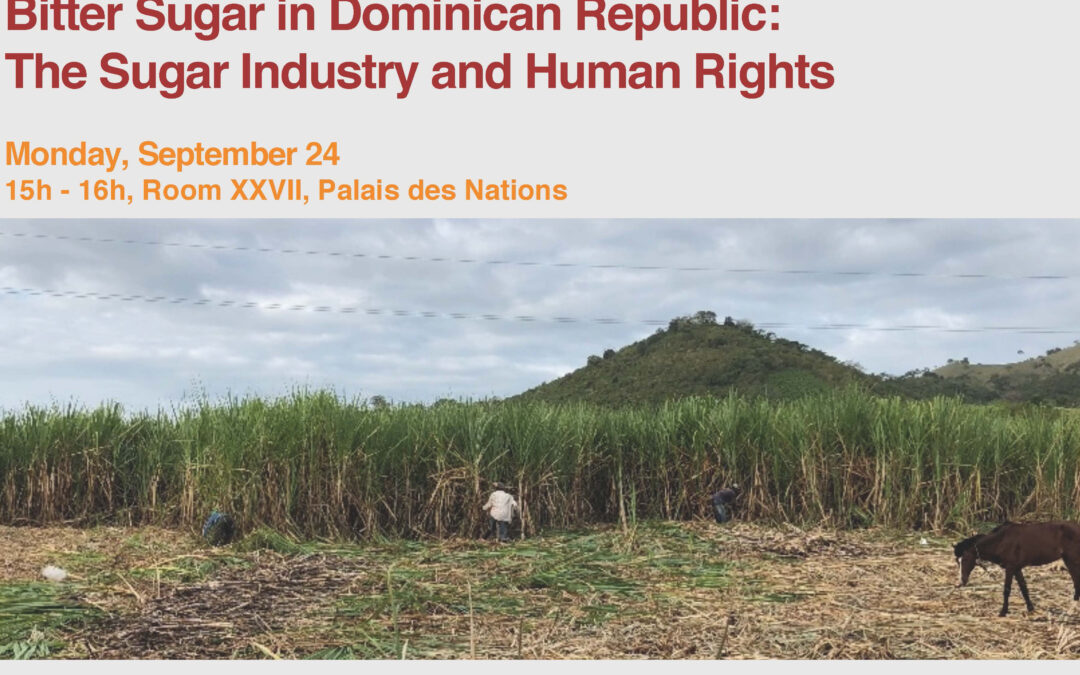Sep 26, 2018 | Advocacy, Non-legal submissions
The ICJ today emphasised the continuing failure of domestic accountability mechanisms to ensure proper accountability for crimes under international law in Libya, speaking at the UN Human Rights Council in Geneva.
The statement, made during an Interactive Dialogue with the UN High Commissioner for Human Rights on her oral update on the situation in Libya, at the Human Rights Council in Geneva, read as follows:
“Mr President,
The International Commission of Jurists (ICJ) remains concerned by the scale and magnitude of the human rights violations that continue in Libya, and the failure of domestic accountability mechanisms to address them.
Impunity prevails for crimes under international law committed during and after the 2011 uprising, including extrajudicial killings, torture and other ill-treatment, and enforced disappearances. Broad amnesty laws allow those responsible to avoid prosecution.
Even in the rare cases where former officials of the Gadhafi regime have faced trial,[1] the integrity of the justice process has been compromised by failures to respect international fair trial standards, including the right to legal counsel and the right to call and examine witnesses.
On August 15, 2018, following an unfair mass trial, 99 defendants were convicted for the killing of 146 anti-Gaddafi protesters in Tripoli during the 2011 uprising.[2] 45 were sentenced to death, violating the right to life.
Such unfair trials and unlawful sentences not only violate the human rights of the accused: they deprive the victims of the crimes of the right to know the truth about the legacy of past violations and the legitimate and untainted justice to which they are entitled. New, fair trials are required.
Political and security instability in Libya undermines the ability of the judiciary to administer justice independently and impartially, including with a view to combating impunity. Judges and prosecutors are threatened, intimidated, abducted and in some instances killed, particularly when attempting to address crimes by members of armed groups.
The ICJ would like to ask the High Commissioner, how can other States and civil society help ensure that Libya, while fully cooperating with the International Criminal Court, implements an effective legal and practical framework to address crimes under international law and eradicate impunity?
Thank you.”
[1] Case 630/2012.
[2] https://www.hrw.org/news/2018/08/22/libya-45-sentenced-death-2011-killings.

Sep 24, 2018 | Feature articles, News
On October 16, 1998, the former dictator of Chile Augusto Pinochet was arrested in London on a warrant from a Spanish judge. Reed Brody participated in the subsequent legal case.
Reed Brody went on to apply the “Pinochet precedent” in the landmark prosecution of the former dictator of Chad, Hissène Habré, who was convicted of crimes against humanity in Senegal in 2016.
He now works with victims of the former dictator of Gambia, Yahya Jammeh. The ICJ interviewed Brody about the Pinochet case and its legacy.
What was your role in the Pinochet case?
My role started when Pinochet was arrested in London. The case began long before that, of course, in the early years of Pinochet’s dictatorship when brave human rights activists documented each case of murder, and “disappearance.”
The ICJ worked with those advocates to produce a seminal 1974 report on those crimes, just six months after Pinochet’s coup. Shut out of Chile’s courts, even after the democratic transition of 1990, victims and their lawyers pursued a case against Pinochet in Spain under its “universal jurisdiction” law and when Pinochet traveled to London, Spanish Judge Baltasar Garzón requested and obtained his detention.
When Pinochet challenged his arrest in court claiming immunity as a former head of state, I went to London for Human Rights Watch, and we and Amnesty International were granted the right to intervene with teams of lawyers in the proceedings at the judicial committee of the House of Lords, then Britain’s highest court.
The Lords cited our research in rejecting Pinochet’s immunity.
You famously described the Lords’ Pinochet decision as a “wake-up call” to tyrants everywhere. Looking back, do you think it was?
Actually no, I think one would be hard pressed to discern a change in the behavior of dictators. Mugabe didn’t quake in his boots, Saddam didn’t clean up his act.
The more important and more lasting effect of the case was to give hope to other victims and activists. When the Lords ruled that Pinochet could be arrested anywhere in the world despite his status as a former head of state, the movement was in effervescence.
As a human rights lawyer, I was used to being legally and morally right, but still losing. In the Pinochet case, not only did we win, but we upheld the detention of one of the world’s most iconic dictators.
The Pinochet case inspired victims of abuse in country after country, particularly in Latin America, to challenge the transitional arrangements of the 1980s and 1990s, which allowed the perpetrators of atrocities to go unpunished and, often, to remain in power.
These temporary accommodations with the ancien régime didn’t extinguish the victims’ thirst to bring their former tormentors to justice.
How did you go from Pinochet to Habré?
With Pinochet, we saw that universal jurisdiction could be used as an instrument to bring to book people who seemed out of the reach of justice.
Together with groups like Amnesty, the FIDH, and the ICJ (which wrote an important report on the Pinochet case and its lessons), we had meetings on who could be the “next Pinochet.”
That’s when Delphine Djiraibe of the Chadian Association for Human Rights asked us to help Habre’s victims bring him to justice in his Senegalese exile.
I was excited at the prospect of persuading a country in the Global South, Senegal, to exercise universal jurisdiction, because there was a developing paradigm of European courts prosecuting defendants from formerly colonized countries.
It took us 17 years, but Habré became the first prosecution ever of a former head of state using universal jurisdiction, and indeed the first universal jurisdiction trial in Africa.
1998 was a high water mark for international justice with the adoption of the ICC Rome Statute and Pinochet’s arrest. Neither the ICC nor universal jurisdiction have quite lived up to their expectations. Why?
International justice doesn’t operate in a vacuum, it’s conditioned by the global power structure. Each case, whether at the ICC level or the transnational level, is a product of the political forces which must be mobilized, or fended off, to allow a prosecution to proceed.
Those forces, particularly since September 11, 2001, have been hostile to human rights enforcement in general and to justice in particular. Universal jurisdiction has been subject to the same double standards as the ICC.
The Belgian and Spanish universal jurisdiction laws, which were the broadest in the world, were both repealed when they were used to investigate superpower actions.
But many of the most successful cases have been those in which the victims and their activist supporters have been the driving forces, have compiled the evidence themselves, built an advocacy coalition which placed the victims and their stories at the center of the justice struggle and helped create the political will in the forum state.
I’m thinking not just of Habré, but the genocide prosecution in Guatemala of the former dictator Efraín Ríos Montt, the case in Haiti of “President for Life,” Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, the Liberian cases brought around the world by Civitas Maxima and its partners, the Swiss cases initiated by TRIAL International, and the Syria litigation by ECCHR and others.
These cases were brought before domestic courts either of the country in which the atrocities took place (Guatemala, Haiti) or of foreign countries based on universal jurisdiction, rather than before international courts.
Most of these cases took advantage of legal regimes which allowed victims directly to participate in the prosecutions as “parties civiles,” or “acusación particular” rather than play passive or secondary roles in cases prosecuted solely by state or international officials.
How do victim-driven prosecutions look different than institutional cases?
When it’s the victims and their allies who get the cases before a court, who gather the evidence, and who have formal standing as parties, the trials are more likely to live up to their expectations.
In the Rios Montt case, for instance, the Asociación Para la Justicia y Reconciliacion (AJR) and the Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) mobilized the victims, developed the evidence, defined the narrative and, essentially, determined the outlines of the case and chose the witnesses who would testify for the prosecution.
In the Habré case, we spent 13 years building the dossier, interviewing hundreds of victims and former officials and uncovering regime police files. The victims’ coalition always insisted that any trial include crimes committed against each of Chad’s victimized ethnic groups, and that is exactly was happened.
In contrast, a distant prosecutor, disconnected from national narratives and inherently not accountable to the victims or civil society, can be tempted to narrowly tailor prosecutions in the hopes of securing a conviction or avoiding political resistance.
This was the case with the ICC in the Democratic Republic of the Congo, for instance, where, as Pascal Kambale has persuasively argued, it betrayed the victims’ hopes.
Millions of civilians died in the DRC and Luis Moreno Ocampo only went after two local warlords. I think the current prosecutor is paying more attention to local realities.
The inspiration from victim-driven cases is also greater, and they are to some degree replicable. As Naomi Roht-Arriaza has written, these cases “stirred imaginations and opened possibilities precisely because they seemed decentralized, less controllable by state interests, more, if you will, acts of imagination.”
When I showed Chadian victims video clips of the Ríos Montt trial, they saw in those images exactly what they were trying to do.
Just as the Chadians came to us in the Habré case seeking to do what Pinochet’s victims had done, our hope in getting the Habré case to trial was that other survivors would be inspired by what Habre’s victims had done and say, “you see these people, they fought for justice and never gave up. We can do that too.”
And indeed, Liberian victims and Gambian victims have patterned their campaigns for justice on what Habre’s victims did. So, the Pinochet case continues to be an inspiration.

Sep 24, 2018 | Nouvelles
Le 16 octobre 1998, l’ancien dictateur chilien, Augusto Pinochet, a été arrêté à Londres sur mandat d’un juge espagnol. Reed Brody a participé à la procédure judiciaire ultérieure.
Reed Brody a ensuite appliqué le «précédent Pinochet» dans la poursuite marquante de l’ancien dictateur tchadien, Hissène Habré, reconnu coupable de crimes contre l’humanité au Sénégal en 2016.
Il travaille maintenant avec les victimes de l’ancien dictateur de Gambie, Yahya Jammeh. La CIJ a interrogé Brody sur l’affaire Pinochet et son héritage.
Quel a été votre rôle dans l’affaire Pinochet?
Mon rôle a commencé lorsque Pinochet a été arrêté à Londres. L’affaire a commencé bien avant, bien sûr, dans les premières années de la dictature de Pinochet, lorsque de courageux militants des droits de l’Homme ont documenté chaque cas de meurtre et de «disparition».
La CIJ a travaillé avec ces défenseurs pour produire un rapport crucial sur ces crimes en 1974, six mois seulement après le coup d’État de Pinochet. Exlus des tribunaux chiliens, même après la transition démocratique de 1990, les victimes et leurs avocats ont engagé une action en justice contre Pinochet en Espagne en vertu de la loi en matière de “compétence universelle”, et lorsque Pinochet s’est rendu à Londres, le juge espagnol Baltasar Garzón a demandé et obtenu sa détention.
Lorsque Pinochet a contesté son arrestation devant un tribunal, affirmant son immunité en tant qu’ancien chef d’État, je me suis rendu à Londres pour le compte d’Human Rights Watch, et avec Amnesty International nous avons obtenu le droit d’intervenir avec des équipes d’avocats dans les procédures auprès du comité judiciaire de la Chambre des lords, la plus haute cour de Grande-Bretagne.
Les Lords ont cité nos recherches pour rejeter l’immunité de Pinochet.
Vous avez décrit la décision des Lords concernant Pinochet comme un «signal d’alarme» pour des tyrans où qu’ils soient. En regardant en arrière, pensez-vous que c’était le cas?
En fait non, je pense qu’il serait difficile de discerner un changement de comportement des dictateurs. Mugabe n’a pas tremblé dans ses bottes, Saddam n’a pas mis de l’ordre dans ses affaires.
L’effet le plus important et le plus durable de l’affaire était de donner espoir à d’autres victimes et militants. Lorsque les Lords ont décidé que Pinochet pouvait être arrêté n’importe où dans le monde, malgré son statut d’ancien chef d’État, le mouvement était en effervescence.
En tant qu’avocat des droits de l’Homme, j’avais l’habitude d’avoir raison légalement et moralement, mais de perdre quand même. Dans l’affaire Pinochet, non seulement nous avons gagné, mais nous avons également confirmé la détention de l’un des dictateurs les plus emblématiques du monde.
L’affaire Pinochet a incité des victimes d’abus un pays après l’autre, notamment en Amérique latine, à contester les dispositions transitoires des années 80 et 90 qui permettaient aux auteurs d’atrocités de rester impunis et, souvent, de rester au pouvoir.
Ces arrangements temporaires avec l’ancien régime n’ont pas éteint la soif des victimes de traduire leurs anciens bourreaux en justice .
Comment êtes-vous passé de Pinochet à Habré?
Avec Pinochet, nous avons vu que la compétence universelle pouvait être utilisée comme un instrument permettant de traduire en justice des personnes qui semblaient hors de portée de la justice.
Ensemble avec des groupes comme Amnesty, la FIDH et la CIJ (qui a rédigé un important rapport sur l’affaire Pinochet et de ses leçons), nous avons eu des réunions pour déterminer qui pourrait être le «prochain Pinochet».
C’est alors que Delphine Djiraibe de l’Association tchadienne des droits de l’Homme nous a demandé d’aider les victimes de Habré à le traduire en justice dans son exil sénégalais.
J’étais enthousiaste à la perspective de persuader un pays du Sud, le Sénégal, d’exercer une compétence universelle, car il existait un paradigme en développement dans lequel les tribunaux européens poursuivaient les accusés de pays anciennement colonisés.
Cela nous a pris 17 ans, mais Habré est devenu la première mise en accusation d’un ancien chef d’État grâce à la compétence universelle, et même le premier procès de compétence universelle en Afrique.
L’année 1998 a été un seuil important pour la justice internationale avec l’adoption du Statut de Rome de la CPI et l’arrestation de Pinochet. Ni la CPI ni les juridictions universelles n’ont été à la hauteur de leurs attentes. Pourquoi?
La justice internationale ne fonctionne pas dans le vide, elle est conditionnée par la structure du pouvoir mondial. Chaque cas, que ce soit au niveau de la CPI ou au niveau transnational, est le produit des forces politiques qui doivent être mobilisées ou repoussées pour permettre à une mise en accusation de progresser.
Ces forces, en particulier depuis le 11 septembre 2001, ont été hostiles à l’application des droits de l’homme en général et à la justice en particulier. La compétence universelle a été soumise aux mêmes doubles standards que la CPI.
Les lois en matière de juridiction universelle belge et espagnole, qui étaient les plus larges au monde, ont été abrogées lorsqu’elles ont été utilisées pour enquêter sur des actions de superpuissances.
Mais bon nombre des cas les plus réussis ont été ceux dans lesquels les victimes et leurs défenseurs militants ont été les forces motrices, ont rassemblé les preuves elles-mêmes, construit une coalition de plaidoyer plaçant les victimes et leurs récits au centre de la lutte pour la justice, et ont aidé à créer la volonté politique dans l’État du for.
Je ne pense pas seulement à Habré, mais aux poursuites pour génocide au Guatemala de l’ancien dictateur Efraín Ríos Montt, l’affaire haïtienne du «président à vie», Jean-Claude «Baby Doc» Duvalier, les affaires libériennes portées à travers le monde par Civitas Maxima et ses partenaires, les affaires suisses initiées par TRIAL International et le litige sur la Syrie par ECCHR et d’autres.
Ces affaires ont été portées devant les tribunaux nationaux du pays dans lequel les atrocités ont été commises (Guatemala, Haïti) ou de pays étrangers fondés sur une compétence universelle plutôt que devant des tribunaux internationaux.
La plupart de ces affaires ont tiré parti de régimes juridiques autorisant les victimes à participer directement aux poursuites en tant que «parties civiles» ou «acusación particular» plutôt que de jouer des rôles passifs ou secondaires dans des affaires uniquement intentées par des responsables nationaux ou internationaux.
Comment les poursuites engagées par les victimes sont-elles différentes des affaires institutionnelles?
Quand ce sont les victimes et leurs alliés qui amènent les cas devant un tribunal, qui recueillent les preuves et qui ont qualité pour agir, les procès ont plus de chances de répondre à leurs attentes.
Dans l’affaire Rios Montt, par exemple, l’Asociación Para la Justicia y Reconciliacion (AJR) et le Centro Para la Acción Legal and Derechos Humanos (CALDH) ont mobilisé les victimes, développé les éléments de preuve, défini le récit et, pour l’essentiel, déterminé les contours du dossier et choisi les témoins qui témoigneraient pour l’accusation.
Dans l’affaire Habré, nous avons passé 13 ans à construire le dossier, à interroger des centaines de victimes et d’anciens responsables et à mettre à jour les dossiers de la police du régime. La coalition des victimes a toujours insisté pour que tous les procès incluent des crimes commis contre chacun des groupes ethniques victimes au Tchad, et c’est exactement ce qui s’est passé.
En revanche, un procureur éloigné, déconnecté des discours nationaux et, par nature, pas redevable face aux victimes et à la société civile, peut être tenté de restreindre à sa guise les poursuites en justice dans l’espoir d’obtenir une condamnation ou d’éviter une résistance politique.
C’est le cas de la CPI en République démocratique du Congo, par exemple, où, comme le soutient Pascal Kambale, elle a trahi les espoirs des victimes.
Des millions de civils sont morts en RDC et Luis Moreno Ocampo ne s’en est pris qu’à deux chefs de guerre locaux. Je pense que l’actuel procureur accorde plus d’attention aux réalités locales.
L’inspiration tirée des cas menés par les victimes est également plus grande et peuvent, dans une certaine mesure, être reproduits. Comme Naomi Roht-Arriaza l’a écrit, ces affaires ont «suscité l’imagination et ouvert des possibilités, précisément parce qu’elles semblaient décentralisées, moins contrôlables par les intérêts de l’État et davantage, si vous voulez, d’actions imaginables ».
Quand j’ai montré aux victimes tchadiennes des clips vidéo du procès Ríos Montt, elles ont vu dans ces images exactement ce qu’elles essayaient de faire.
Tout comme les Tchadiens sont venus nous voir dans l’affaire Habré pour tenter de faire ce que les victimes de Pinochet avaient fait, notre espoir en portant l’affaire Habré devant les tribunaux était que d’autres survivants s’inspirent de ce que les victimes de Habré ont fait et disent: «Vous voyez ces personnes , ils se sont battus pour la justice et n’ont jamais abandonné. Nous pouvons le faire également.”
Et en effet, les victimes libériennes et gambiennes ont structuré leurs campagnes en faveur de la justice sur ce que les victimes de Habré ont fait. Ainsi, l’affaire Pinochet continue d’être une source d’inspiration.

Sep 21, 2018 | Nouvelles, Plaidoyer
La CIJ a écrit aujourd’hui à la Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović, pour demander d’intervenir contre la décision des autorités turques d’interdire l’accès à la place Galatasaray d’Istanbul (Turquie) à un collectif de mères de personnes disparues appelées « les Mères du samedi ».
Le 25 août 2018, le sous-gouvernorat du district de Beyoğlu à Istanbul a prononcé une interdiction de se rassembler pour tout type de manifestation sur la place Galatasaray à Istanbul, la place où ont pris l’habitude de se réunir chaque samedi « les Mères du samedi » d’abord de 1995 à 1998, et ensuite de 2009 jusqu’à 2018.
À la 700ème semaine de leurs manifestations pacifiques, les Mères du samedi et leurs partisans se sont réunis en milieu de journée sur la place Galatasaray pour sensibiliser une fois de plus sur la nécessité pour les responsables des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées les années 1990 de rendre des comptes.
La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour mettre fin à la manifestation et a arrêté 47 personnes. Toutes ont été libérées samedi soir.
Des officiers supérieurs des autorités turques ont même publié des déclarations accusant les Mères du samedi d’avoir été abusées par des organisations terroristes ou d’être en collusion avec elles.
La CIJ a écrit au Commissaire européen aux droits de l’Homme qu’elle « considère que cette situation est contraire aux obligations de la Turquie en vertu du droit international humanitaire, en particulier du droit de réunion pacifique en vertu de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ».
La CIJ a ajouté que « compte tenu de la constance et de la présence des Mères du samedi sur la place Galatasaray au fil des ans, il est difficile de voir comment la restriction de leur droit de réunion pacifique pourrait être nécessaire et proportionnée à un objectif légitime.
Il est clair qu’aucun avertissement préalable pour le rassemblement n’était nécessaire pour des raisons de sécurité compte tenu de son occurrence régulière au moins depuis sa reprise en 2009, c’est-à-dire il y a neuf ans. En outre, la manifestation a eu lieu dans une zone piétonne où les voitures ne sont pas autorisées ».
ICJ-Letter-SaturdayMothers-CoEComm-Turkey-2018-ENG (télécharger la lettre, uniquement disponible en anglais)
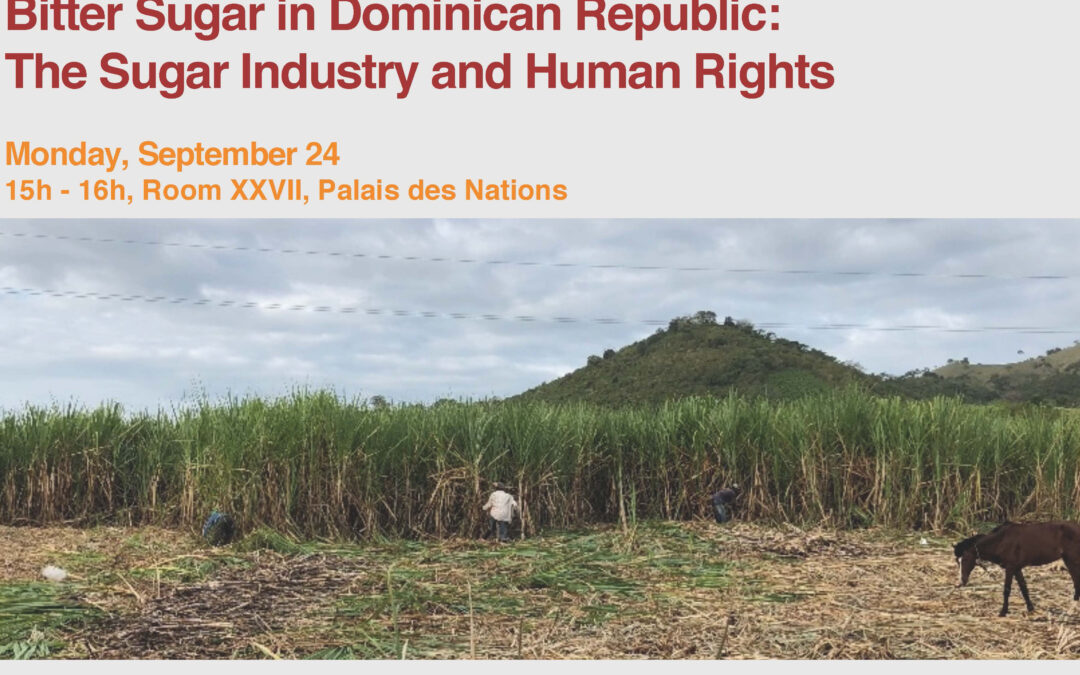
Sep 19, 2018 | Eventos, Noticias
La CIJ acogerá el evento paralelo, “Azúcar amargo en la República Dominicana: la industria azucarera y los derechos humanos” el lunes, 24 septiembre 2018 de 15:00-16:00 habitación XXVII, en el Palais de Nations en Ginebra.
Junto con el turismo, la producción de azúcar es una de las principales industrias y una de las mayores fuentes de empleo en la República Dominicana.
Este pequeño estado caribeño sigue siendo uno de los principales proveedores mundiales de azúcar en los Estados Unidos.
Si bien la producción y exportación de azúcar en la República Dominicana son unas fuentes importantes de ingresos para el país, los impactos adversos de su producción son varios.
La destrucción del medio ambiente, el acceso reducido a la tierra para las comunidades locales, los desalojos forzosos y las condiciones laborales precarias en las plantaciones de caña de azúcar son lamentablemente una realidad en muchas regiones del estado caribeño.
Mientras que la República Dominicana ha demostrado en los últimos años estar preparada para cumplir y aplicar las normas internacionales sobre asuntos relacionados con las empresas y los derechos humanos, el país sigue enfrentando muchos desafíos y las evidencias de violaciones de derechos humanos proviniendo del terreno todavía pintan una realidad complicada.
Dos ejemplos recientes involucrando la industria de la caña de azúcar ilustran la preocupación constante por los abusos contra los derechos humanos en la República Dominicana.
En 2016, agentes armados de uno de los mayores productores de azúcar del país, Central Romana Corp., expulsaron por la fuerza de sus hogares a más de 60 familias durante la noche.
No se han proporcionado alojamiento alternativo o reparaciones a las víctimas para reparar la destrucción de sus hogares y el trauma causado por la violencia de los desalojos.
En 2017, el Grupo Vicini, la segunda principal empresa productora de azúcar del país, utilizó el pesticida glifosato de tal manera que muchas personas corrieron peligro de muerte y que destruyó los cultivos y el ganado de los campesinos. Hasta la fecha, las violaciones de los derechos humanos en ambos casos siguen impunes.
Existe una creciente preocupación internacional de que la industria de la caña de azúcar en la República Dominicana puede de alguna manera actuar con impunidad cuando se trata de violaciones de derechos humanos.
Teniendo en cuenta el próximo Examen Periódico Universal de la República Dominicana, en el cual todos los Estados Miembros de la ONU examinarán la situación de los derechos humanos en el país, este evento paralelo tiene como objetivo informar y arrojar luz sobre esta realidad poco conocida en la República Dominicana e informar a las delegaciones estatales sobre la importancia de abordar este tema en su revisión de la República Dominicana.
El evento también proporcionará un espacio para el diálogo constructivo entre varios actores, incluido el Gobierno de la República Dominicana.
Panelistas:
– Un experto sobre el tema de las empresas y los derechos humanos (Carlos Lopez, Comisión Internacional de Juristas)
– Un experto sobre el tema de la industria azucarera en la República Dominicana y sus impactos sobre los derechos humanos (Fr. Damián Calvo Martin OP, Centro de Teología Santo Domingo de Guzman)
– Una víctima de desalojos forzosos por parte de Central Romana Corp. (María Magdalena Álvarez Gálvez)
Moderador: Rory Gogarty, High Court of England and Wales
Interpretación: se proporcionará de inglés a español y de español a inglés
República Dominicana evento 24 septiembre (volante de evento en PDF)