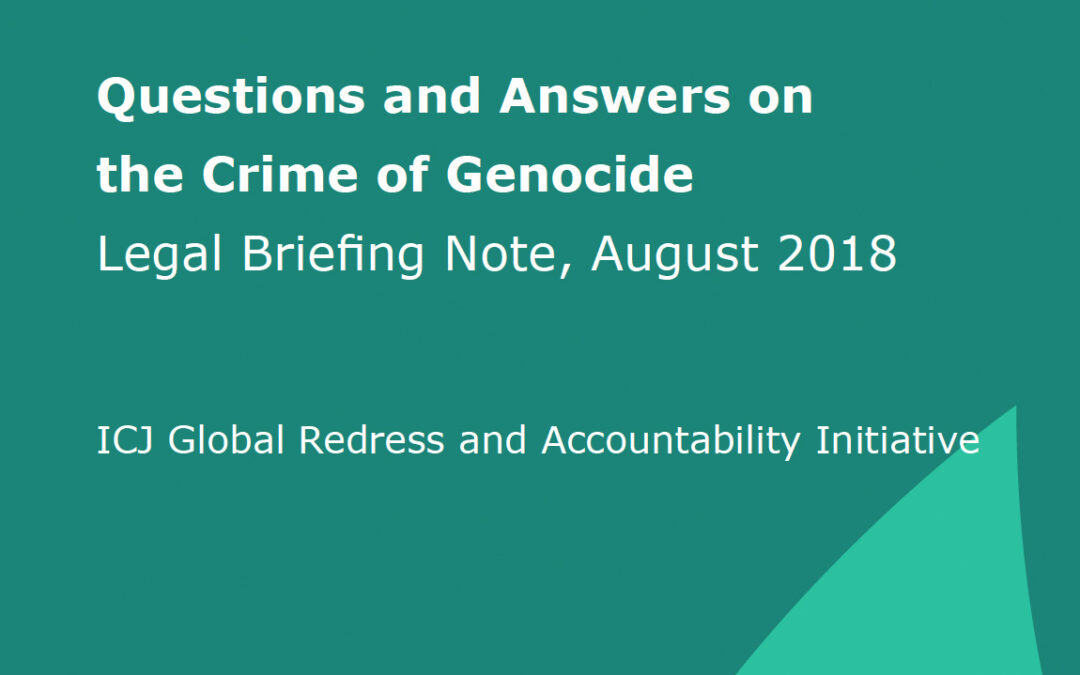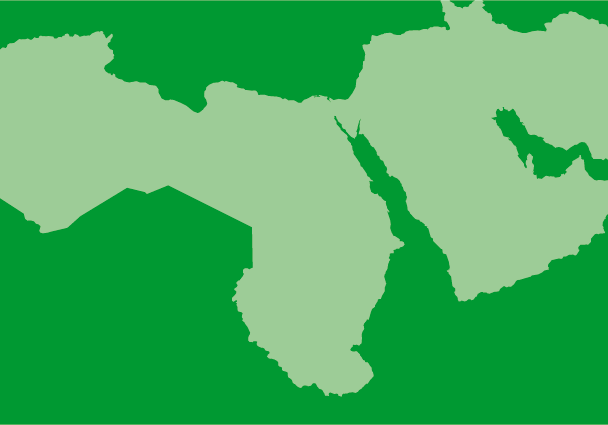Reed Brody, commissaire à la CIJ: «Vingt ans après, l’arrestation de Pinochet reste une source d’inspiration»
Le 16 octobre 1998, l’ancien dictateur chilien, Augusto Pinochet, a été arrêté à Londres sur mandat d’un juge espagnol. Reed Brody a participé à la procédure judiciaire ultérieure.
Reed Brody a ensuite appliqué le «précédent Pinochet» dans la poursuite marquante de l’ancien dictateur tchadien, Hissène Habré, reconnu coupable de crimes contre l’humanité au Sénégal en 2016.
Il travaille maintenant avec les victimes de l’ancien dictateur de Gambie, Yahya Jammeh. La CIJ a interrogé Brody sur l’affaire Pinochet et son héritage.
Quel a été votre rôle dans l’affaire Pinochet?
Mon rôle a commencé lorsque Pinochet a été arrêté à Londres. L’affaire a commencé bien avant, bien sûr, dans les premières années de la dictature de Pinochet, lorsque de courageux militants des droits de l’Homme ont documenté chaque cas de meurtre et de «disparition».
La CIJ a travaillé avec ces défenseurs pour produire un rapport crucial sur ces crimes en 1974, six mois seulement après le coup d’État de Pinochet. Exlus des tribunaux chiliens, même après la transition démocratique de 1990, les victimes et leurs avocats ont engagé une action en justice contre Pinochet en Espagne en vertu de la loi en matière de “compétence universelle”, et lorsque Pinochet s’est rendu à Londres, le juge espagnol Baltasar Garzón a demandé et obtenu sa détention.
Lorsque Pinochet a contesté son arrestation devant un tribunal, affirmant son immunité en tant qu’ancien chef d’État, je me suis rendu à Londres pour le compte d’Human Rights Watch, et avec Amnesty International nous avons obtenu le droit d’intervenir avec des équipes d’avocats dans les procédures auprès du comité judiciaire de la Chambre des lords, la plus haute cour de Grande-Bretagne.
Les Lords ont cité nos recherches pour rejeter l’immunité de Pinochet.
Vous avez décrit la décision des Lords concernant Pinochet comme un «signal d’alarme» pour des tyrans où qu’ils soient. En regardant en arrière, pensez-vous que c’était le cas?
En fait non, je pense qu’il serait difficile de discerner un changement de comportement des dictateurs. Mugabe n’a pas tremblé dans ses bottes, Saddam n’a pas mis de l’ordre dans ses affaires.
L’effet le plus important et le plus durable de l’affaire était de donner espoir à d’autres victimes et militants. Lorsque les Lords ont décidé que Pinochet pouvait être arrêté n’importe où dans le monde, malgré son statut d’ancien chef d’État, le mouvement était en effervescence.
En tant qu’avocat des droits de l’Homme, j’avais l’habitude d’avoir raison légalement et moralement, mais de perdre quand même. Dans l’affaire Pinochet, non seulement nous avons gagné, mais nous avons également confirmé la détention de l’un des dictateurs les plus emblématiques du monde.
L’affaire Pinochet a incité des victimes d’abus un pays après l’autre, notamment en Amérique latine, à contester les dispositions transitoires des années 80 et 90 qui permettaient aux auteurs d’atrocités de rester impunis et, souvent, de rester au pouvoir.
Ces arrangements temporaires avec l’ancien régime n’ont pas éteint la soif des victimes de traduire leurs anciens bourreaux en justice .
Comment êtes-vous passé de Pinochet à Habré?
Avec Pinochet, nous avons vu que la compétence universelle pouvait être utilisée comme un instrument permettant de traduire en justice des personnes qui semblaient hors de portée de la justice.
Ensemble avec des groupes comme Amnesty, la FIDH et la CIJ (qui a rédigé un important rapport sur l’affaire Pinochet et de ses leçons), nous avons eu des réunions pour déterminer qui pourrait être le «prochain Pinochet».
C’est alors que Delphine Djiraibe de l’Association tchadienne des droits de l’Homme nous a demandé d’aider les victimes de Habré à le traduire en justice dans son exil sénégalais.
J’étais enthousiaste à la perspective de persuader un pays du Sud, le Sénégal, d’exercer une compétence universelle, car il existait un paradigme en développement dans lequel les tribunaux européens poursuivaient les accusés de pays anciennement colonisés.
Cela nous a pris 17 ans, mais Habré est devenu la première mise en accusation d’un ancien chef d’État grâce à la compétence universelle, et même le premier procès de compétence universelle en Afrique.
L’année 1998 a été un seuil important pour la justice internationale avec l’adoption du Statut de Rome de la CPI et l’arrestation de Pinochet. Ni la CPI ni les juridictions universelles n’ont été à la hauteur de leurs attentes. Pourquoi?
La justice internationale ne fonctionne pas dans le vide, elle est conditionnée par la structure du pouvoir mondial. Chaque cas, que ce soit au niveau de la CPI ou au niveau transnational, est le produit des forces politiques qui doivent être mobilisées ou repoussées pour permettre à une mise en accusation de progresser.
Ces forces, en particulier depuis le 11 septembre 2001, ont été hostiles à l’application des droits de l’homme en général et à la justice en particulier. La compétence universelle a été soumise aux mêmes doubles standards que la CPI.
Les lois en matière de juridiction universelle belge et espagnole, qui étaient les plus larges au monde, ont été abrogées lorsqu’elles ont été utilisées pour enquêter sur des actions de superpuissances.
Mais bon nombre des cas les plus réussis ont été ceux dans lesquels les victimes et leurs défenseurs militants ont été les forces motrices, ont rassemblé les preuves elles-mêmes, construit une coalition de plaidoyer plaçant les victimes et leurs récits au centre de la lutte pour la justice, et ont aidé à créer la volonté politique dans l’État du for.
Je ne pense pas seulement à Habré, mais aux poursuites pour génocide au Guatemala de l’ancien dictateur Efraín Ríos Montt, l’affaire haïtienne du «président à vie», Jean-Claude «Baby Doc» Duvalier, les affaires libériennes portées à travers le monde par Civitas Maxima et ses partenaires, les affaires suisses initiées par TRIAL International et le litige sur la Syrie par ECCHR et d’autres.
Ces affaires ont été portées devant les tribunaux nationaux du pays dans lequel les atrocités ont été commises (Guatemala, Haïti) ou de pays étrangers fondés sur une compétence universelle plutôt que devant des tribunaux internationaux.
La plupart de ces affaires ont tiré parti de régimes juridiques autorisant les victimes à participer directement aux poursuites en tant que «parties civiles» ou «acusación particular» plutôt que de jouer des rôles passifs ou secondaires dans des affaires uniquement intentées par des responsables nationaux ou internationaux.
Comment les poursuites engagées par les victimes sont-elles différentes des affaires institutionnelles?
Quand ce sont les victimes et leurs alliés qui amènent les cas devant un tribunal, qui recueillent les preuves et qui ont qualité pour agir, les procès ont plus de chances de répondre à leurs attentes.
Dans l’affaire Rios Montt, par exemple, l’Asociación Para la Justicia y Reconciliacion (AJR) et le Centro Para la Acción Legal and Derechos Humanos (CALDH) ont mobilisé les victimes, développé les éléments de preuve, défini le récit et, pour l’essentiel, déterminé les contours du dossier et choisi les témoins qui témoigneraient pour l’accusation.
Dans l’affaire Habré, nous avons passé 13 ans à construire le dossier, à interroger des centaines de victimes et d’anciens responsables et à mettre à jour les dossiers de la police du régime. La coalition des victimes a toujours insisté pour que tous les procès incluent des crimes commis contre chacun des groupes ethniques victimes au Tchad, et c’est exactement ce qui s’est passé.
En revanche, un procureur éloigné, déconnecté des discours nationaux et, par nature, pas redevable face aux victimes et à la société civile, peut être tenté de restreindre à sa guise les poursuites en justice dans l’espoir d’obtenir une condamnation ou d’éviter une résistance politique.
C’est le cas de la CPI en République démocratique du Congo, par exemple, où, comme le soutient Pascal Kambale, elle a trahi les espoirs des victimes.
Des millions de civils sont morts en RDC et Luis Moreno Ocampo ne s’en est pris qu’à deux chefs de guerre locaux. Je pense que l’actuel procureur accorde plus d’attention aux réalités locales.
L’inspiration tirée des cas menés par les victimes est également plus grande et peuvent, dans une certaine mesure, être reproduits. Comme Naomi Roht-Arriaza l’a écrit, ces affaires ont «suscité l’imagination et ouvert des possibilités, précisément parce qu’elles semblaient décentralisées, moins contrôlables par les intérêts de l’État et davantage, si vous voulez, d’actions imaginables ».
Quand j’ai montré aux victimes tchadiennes des clips vidéo du procès Ríos Montt, elles ont vu dans ces images exactement ce qu’elles essayaient de faire.
Tout comme les Tchadiens sont venus nous voir dans l’affaire Habré pour tenter de faire ce que les victimes de Pinochet avaient fait, notre espoir en portant l’affaire Habré devant les tribunaux était que d’autres survivants s’inspirent de ce que les victimes de Habré ont fait et disent: «Vous voyez ces personnes , ils se sont battus pour la justice et n’ont jamais abandonné. Nous pouvons le faire également.”
Et en effet, les victimes libériennes et gambiennes ont structuré leurs campagnes en faveur de la justice sur ce que les victimes de Habré ont fait. Ainsi, l’affaire Pinochet continue d’être une source d’inspiration.